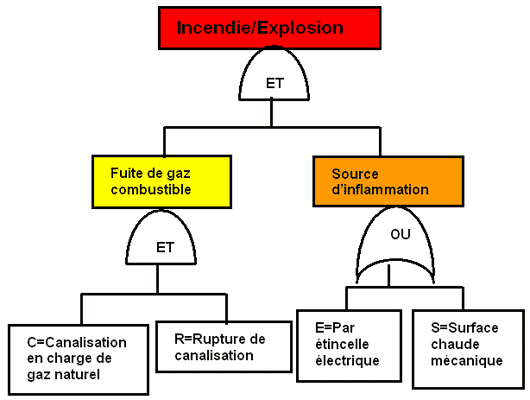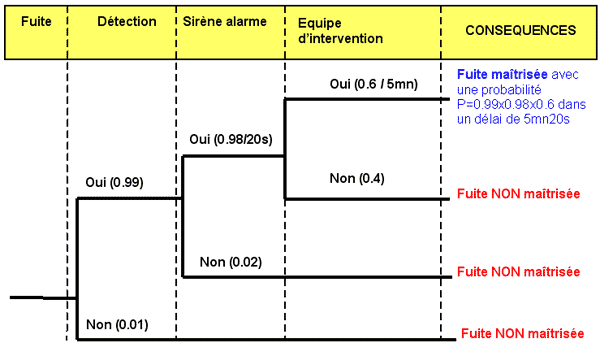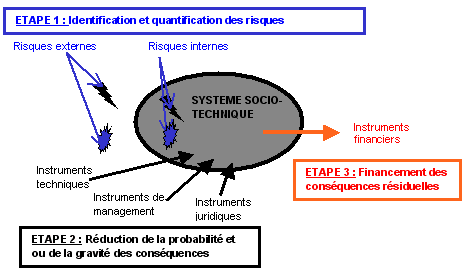Caractérisation et évalutation des risques technologiques et naturels
Caractérisation et évaluation des risques technologiques majeurs
Quels outils pour l’identification et l’analyse des risques ?
Les industries qui présentent des niveaux de risques importants sont soumises à la réglementation des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE). Certaines doivent produire une étude de danger et une étude d’impact pour obtenir l’autorisation d’exploiter. L’étude de danger permet de recenser les différents risques auxquels est soumise l’installation et d’estimer la portée des conséquences d’un accident.
Différentes méthodes d’identification et d’analyse des risques peuvent être utilisées à cette fin (Villemeur, 1988). Pour l’identification des risques, deux méthodes sont principalement pratiquées : l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et la Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques (MOSAR). Ces méthodes permettent de recenser l’ensemble des sources de danger présentes dans le système étudié à partir de grilles de référence.
Pour les systèmes présentant des niveaux de risques très importants, des outils de sûreté de fonctionnement peuvent être utilisés pour affiner l’étude (Tixier et al., 2002) (Villemeur, 1988). Il s’agit des arbres de défaillances et des arbres des événements pour les outils dits statiques et des chaînes de Markov et des réseaux de Petri pour les outils dynamiques (Signoret, 2005). Ces outils permettent de construire des scénarios avec des liens de causalités entre différents événements qui participent à la genèse de l’accident. Un exemple d’arbre des défaillances ainsi qu’un exemple d’arbre des événements sont donnés ci-dessous à titre d’exemple.
L’arbre des défaillances correspond à l’événement non souhaité ‘Incendie/explosion’ suite à la rupture d’une canalisation contenant du gaz naturel. Il permet de décrire tous les scénarios d’accidents (les coupes de l’arbre) qui permettent d’atteindre l’ENS. Ces scénarios sont constitué de l’ensemble des événements élémentaires qui doivent se produire de façon concomitante pour que l’ENS se produise. Pour cet exemple, il y a deux scénarios possibles :
L’algèbre booléenne permet de traiter mathématiquement ce type d’arborescence et de déterminer facilement les coupes de l’arbre. Cette méthode est une méthode d’analyse des risques a priori de type déductive.
L’arbre des événements est un outil qui permet d’étudier quelles sont les conséquences d’un ENS suivant le fonctionnement des parades qui sont mises en place pour limiter la gravité des effets de l’ENS sur son environnement. L’exemple donné correspondant au fonctionnement des différentes parades techniques et organisationnelles mises en œuvre suite à une fuite de gaz toxique avec le calcul de la probabilité d’obtenir une fuite maîtrisée dans un délai raisonnable.
Quels outils pour l’estimation des conséquences ?
Les effets des accidents majeurs peuvent être caractérisés à partir du rayonnement thermique pour le risque incendie, de la surpression générée par l’onde de pression pour le risque explosion et de la dose de polluants reçue pour le risque dispersion de polluants.
A titre d’exemple, les valeurs seuils de référence (définies pour le rayonnement thermique) qui permettent de caractériser les effets d’un incendie sont les suivantes :
-
3 kW.m-
2 : seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine,
-
5 kW.m-
2 : seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie humaine,
-
12.6 kW.m-
2 : seuil des effets dominos sur les structures.
Ces niveaux de flux permettent donc de définir une cartographie des risques autour des installations classées à haut risque. Chacune des zones, délimitées en considérant les valeurs seuils précédentes, aura ses propres contraintes en termes d’urbanisme.
Les modèles qui permettent d’estimer ces niveaux sont multiples (INERIS, 2003). Pour le risque incendie, des formules empiriques ont été publiées pour une estimation des niveaux de flux lumineux reçus par une cible. Pour plus de précision, l’expert peut se tourner vers des modèles détaillés (modèles de champs) qui permettent d’affiner les résultats. Pour l’estimation des effets d’une explosion, des modèles empiriques sont usuellement utilisés (modèle de l’équivalent TNT (TriNitriToluène) ou modèle multi-énergie par exemple). La modélisation de la dispersion des polluants s’effectue principalement avec trois types de modèles : modèle gaussien pour des gaz dont la masse volumique est proche de celle de l’air, modèle de gaz lourd (densité par rapport à l’air supérieure à 1) et modèle de champs qui prennent en compte l’effet de la présence d’obstacles et du relief sur la dispersion des polluants.
Quelle démarche générale pour la gestion des risques ?
La norme française ISO/CEI Guide 73 précise les différentes étapes qui constituent la démarche d’analyse et de gestion des risques. Les étapes de cette norme peuvent être résumées ainsi :
-
analyse des risques : définition des objectifs, identification des sources et des risques, estimation des risques,
-
évaluation des risques : choix des critères de risque pour estimer l’importance de chacun,
-
traitement et maîtrise des risques : sélection des mesures/actions visant à limiter l’occurrence et la gravité, mise en œuvre, suivi et contrôle.
Ces différentes étapes peuvent être résumées sous une autre forme d’après le schéma suivant (Barthélemy, 2004) :
Pour chaque risque identifié, il existe plusieurs solutions tant en traitement (protection et/ou prévention) qu’en financement. Un compromis doit être trouvé pour atteindre les objectifs du système considéré en fonction des critères techniques, financiers, sociaux, politiques, etc.
Caractérisation et évaluation des risques naturels
Quelle démarche générale pour la gestion des risques naturels ?
Dans le domaine des risques naturels, bien que des mesures de protection puissent être mises en œuvre, la réduction du niveau de risque est atteinte principalement par des mesures de prévention. C’est l’ensemble des dispositions qui visent à réduire les impacts d’un phénomène :
-
inventaire des aléas et enjeux,
-
information des populations : le préfet dans chaque département, avec la CARIP (Commission d’Analyse des Risques et de l’Information Préventive) recense les communes soumises à risques naturels ou technologiques et réalise le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs), le maire organise l’information de ces concitoyens dans les zones à risques dans le cadre du DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs),
-
connaissance des aléas (processus),
-
réglementation de l’occupation du sol avec la cartographie préventive et le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Les PPRN ont pour objet de délimiter les zones exposées à des risques naturels prévisibles et de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les collectivités publiques ou les particuliers. En matière d’aménagement, le maire élabore les plans d’occupations des sols (POS) ou le plan local d’urbanisme (PLU).
-
prévision et alerte (surveillance) qui dépendent du type d’aléa concerné,
-
plans de secours et gestion de crises.
Le PPR (Plan de Prévention des Risques) comporte une note de présentation ainsi qu’un ou plusieurs documents graphiques (carte informative des phénomènes naturels historiques et actifs , carte des aléas, carte des enjeux, zonage réglementaire). Les risques technologiques sont décrits dans le PPRT avec un principe d’élaboration assez similaire à celui du PPRN.
Ces documents permettent au maire de mettre en place le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) qui décrit l’organisation de la sauvegarde des populations en cas d’accident majeur.
Pour la gestion des risques naturels, les Systèmes d'Information Géographique (SIG) sont très souvent utilisés. Il s’agit de systèmes informatiques qui permettent, à partir de diverses sources, de rassembler, d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement (géoréférencées). L'ensemble des informations géographiques intégrées forment une base de données géographiques. Une information géographique désigne toute information (coordonnées géographiques ou cartographiques et légende) sur des objets ou des phénomènes localisables à la surface de la terre. Un SIG permet par exemple de gérer des informations de divers types (images satellites, photos aériennes, cartes, données chiffrées, bases de données, etc) et de faire des requêtes (classiques et spatiales).