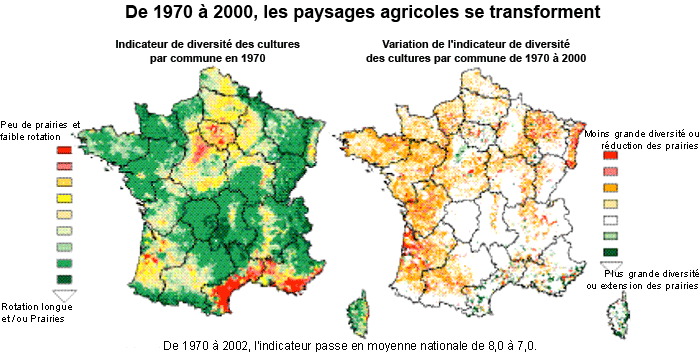Introduction à la notion d’Agriculture Durable
Prévention et gestion des risques ! La presse se fait régulièrement l’écho de risques que fait courir l’agriculture à la société : risques sanitaires, risques environnementaux, risques écologiques.... Le qualificatif de durable, accolé à agriculture, représente souvent la réponse que ces inquiétudes suscitent : une agriculture durable deviendrait ainsi parée de tous les avantages et de toutes les garanties. L’article « agriculture durable » sur wikipedia (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable) met ainsi en exergue dès le début un chapitre intitulé « prévention des risques ».
Nombre de sites décrivent et promeuvent cette agriculture parmi lesquels :
L’objectif général de ce cours est de présenter un certain nombre de concepts et d’exemples pour donner du contenu à la notion d’agriculture durable et éviter ainsi le risque (eh oui, la prévention commence ici) de l’utiliser à tort et à travers et quelquefois sur un mode incantatoire. Il en montrera le caractère polymorphe, la variété des angles d’approche et donc la variété des actions envisageables dans ce domaine.
Nous commencerons par une réflexion sur l’objet de la durabilité : est-ce l’agriculture elle-même ou le développement dont elle est un des éléments qui doit être durable ?
Optant sur la nécessité d’un développement durable dont l’agriculture fait partie plutôt que d’une agriculture durable déconnectée de la société, nous présenterons ensuite quelques grands types de relations qui existent entre agriculture et développement en se posant à chaque fois la question d’analyser comment cette relation contribue ou non à la durabilité : cela constituera autant d’angles d’approche des relations entre agriculture et développement durable, auxquels correspondront des catégories d’acteurs et de porteurs d’enjeux et des moyens d’action différents.
Ce cours introductif n’a pas pour objectif de constituer une somme sur le sujet : il voudrait juste « donner à penser » à ses lecteurs en leur fournissant un cadre d’analyse et d’investigations pour ensuite approfondir, agir et innover dans ce domaine.
Le contenu de ce cours est largement redevable d’un travail collectif organisé par l’INRA ayant abouti à la publication d’une brochure intitulée « Agriculture et Développement Durable ; enjeux et questions de recherche » sous la direction de J Boiffin, B Hubert et N Durand (INRA 2004).
Introduction : agriculture durable ou agriculture dans le développement durable ?
L’agriculture est aujourd’hui en interaction forte avec d’autres usagers du mode rural et d’autres secteurs économiques. Par ailleurs, la société rejette de plus en plus les modèles techniques hérités de la phase de modernisation agricole de l’après-guerre.
Ce double constat aboutit à la nécessité d’abandonner une approche « agricolo - centrée » en procédant à un déplacement de l’angle de vue : plutôt que s’intéresser à une agriculture durable, il s’agira de rechercher les voies permettant à l’agriculture de s’inscrire dans des stratégies de développement durable à différents niveaux d’organisation territoriale
Définition
Agriculture : englobe non seulement la production agricole au sens strict mais aussi toutes les activités de production mettant en valeur des ressources naturelles renouvelables dans les espaces ruraux, périurbains, voire urbains (sylviculture, aquaculture...)
Développement durable : on peut définir le développement comme l’ensemble des processus par lesquels une société se transforme, évaluables par des critères sociaux, économiques et environnementaux. Un développement caractérisé par une économie viable, motrice de progrès sociaux et préservant le renouvellement des ressources sensibles qu’elle exploite ainsi que les capacités productives des milieux en vue d’usages futurs pourra être considéré comme durable.
La problématique revient ainsi à étudier les relations à double sens qui existent entre activités agricoles et processus de développement et à faire émerger de cette étude les modèles techniques et organisationnels ainsi que les modes de régulation susceptibles d’engager le système considéré sur la voie du développement durable (cf : module "Acteurs, Société et Institutions", ressource "agriculture durable").
Nous aborderons les relations entre agriculture et développement durable selon 4 angles de vue différents mais qui donnent des éclairages complémentaires :
-
Les dynamiques territoriales de développement et l’agriculture
-
L’usage et la préservation des ressources naturelles renouvelables
-
L’évolution et l’adaptation des systèmes de production et de transformation agricoles et agroindustriels
-
Les politiques publiques et les marchés : leurs rôles respectifs et leur cohérence vis à vis du développement durable
Remarque
Mode d’emploi et degrés de lecture :
Nous présenterons en quelques lignes ce que l’on peut attendre de chaque angle d’approche. Nous présenterons ensuite dans un encadré quelques exemples d’actions qui nous semblent représentatives de cet angle d’approche et qui lui donneront du contenu concret.
Différentes ressources sont accessibles par lien hypertexte : articles et textes d’approfondissement, sites internet.
La consultation plus ou moins poussée de ces ressources et le temps passé à analyser les exemples peuvent définir autant de degrés de lecture.
Les dynamiques territoriales de développement et l’agriculture
L’analyse de ces dynamiques doit permettre de comprendre la place qu’occupe aujourd’hui l’agriculture dans la différenciation et le développement des territoires.
L’environnement pris dans son acception la plus large pèse fortement sur l’agriculture avec des effets variés. On observe en effet une tension croissante entre d’une part une tendance à la mondialisation des marchés de masse (produits standardisés) et d’autre part des dynamiques locales privilégiant les relations de proximité afin de valoriser certains attributs spécifiques (qualité des produits, sécurité et traçabilité, effets terroirs). Une conséquence majeure de la façon dont cette tension est gérée et assumée est la localisation des activités agricoles, abordable depuis les échelles les plus globales (planète) jusqu’aux plus locales (canton).
En sens inverse, il convient d’analyser finement les rôles que peut jouer l’agriculture vis à vis d’autres activités et usages de l’espace : rôles positifs dans certains cas, négatifs et contradictoires pour d’autres. En définitive, cela doit permettre de définir quelle place les activités agricoles doivent avoir pour assurer un développement durable.
La 3e étape revient ensuite à étudier les facteurs de blocage, contraintes, leviers et opportunités à dégager pour orienter les processus de localisation des activités agricoles de manière à ce que la place de l’agriculture soit en cohérence avec le développement durable du territoire considéré.
L’usage et la préservation des ressources naturelles renouvelables
Même s’il est d’usage de citer les 3 dimensions du développement durable – l’environnement, l’économique et le social – on ne peut retirer à l’environnement son caractère essentiel.
Comme le dit
GODARD (2005), toute activité humaine, tout processus de développement économique ou social a un impact sur l’environnement. Le problème ne réside pas dans l’existence de cet impact qui est inévitable, mais dans le fait que cet impact ne remette pas en cause la conservation de l’environnement « et la capacité des générations futures à subvenir à leurs besoins. ». Il s’agit donc d’inscrire les « conditions de reproduction de l’environnement au sein même des processus de développement, sans les disjoindre ni les reléguer en position subalterne ».
Ces considérations amènent ainsi à focaliser l’attention sur les acteurs et activités, qui de manière plus ou moins directe, affectent le fonctionnement des milieux, déterminent le niveau de pression sur les ressources naturelles et contribuent à leur (plus ou moins bonne) gestion. On s’intéressera donc aux pratiques qui relient les sociétés aux écosystèmes dont elles tirent leurs ressources : occupation des sols, conduites des cultures et des élevages, gestion forestière, gestion des ressources en eau, des déchets... et, en amont, aux dispositifs par lesquels ces pratiques sont régulées. Une attention particulière devra être portée sur la nécessaire articulation d’échelles de temps différentes : le temps « court » des décisions et actions humaines et le temps « long » des processus biophysiques affectés (évolution de la biodiversité, dégradation des sols, des eaux...). Pour réguler de manière pertinente les décisions prises dans le temps court, il sera nécessaire de définir et utiliser des indicateurs fiables des évolutions dans le temps long.
L’évolution et l’adaptation des systèmes de production et de transformation agricoles et agroindustriels
Les entités productives auxquelles on peut se référer pour parler des relations avec le développement dépendent du niveau d’organisation que l’on considère : parcelle ou animal / sole de culture ou troupeau / exploitations agricoles individuelles ou gérées collectivement / filière agricole, bassin de production...
Des facteurs externes de toutes natures exercent des influences sur ces entités leur apportant contraintes et perturbations, face auxquelles elles résistent plus ou moins solidement par des mécanismes matériels, organisationnels, économiques et sociaux. La connaissance de ces influences externes et des mécanismes de réaction des entités productives constitue une première nécessité pour analyser les conditions d’une contribution positive de l’agriculture au développement durable. En retour, les entités productives induisent des externalités positives ou négatives vis à vis du développement durable et ont des capacités plus ou moins importantes à assurer des fonctions autres que productives.
Les entités productives doivent donc être vues simultanément comme résultat et producteur de leur environnement écologique et socio-économique et les caractéristiques de cette relation réciproque doivent être connues pour définir puis utiliser les leviers (innovations techniques, organisationnelles, sociales, économiques...) capables de déplacer le système vers plus de durabilité.
Dans un environnement naturel donné, le poids que fait peser le contexte sur l’entité productive sont essentiellement d’ordre économique (les cours, les marchés, la compétitivité....), réglementaire (lois, règlements, cahier des charges...) et social (histoire, culture, relations de voisinage...). L’entité productive « pèse » sur son environnement par son impact écologique, économique (la richesse et l’emploi créés) et social (nuisances, voisinage...). L’analyse des relations entre entités productives et environnement passera donc inévitablement par une évaluation conjointe des impacts écologiques, économiques et sociaux.
A l’échelle de l’exploitation agricole, cela imposera d’étudier les relations à double sens entre d’une part les choix d’affectation des ressources productives (travail, surface, eau, capital – par exemple, choix d’assolement et/ou d’équipement) et de mise en œuvre technologique (par exemple adoption d’un niveau d’intensification donné, culture sèche ou irriguée...) utilisés et d’autre part les performances technico-économiques à l’échelle directe de l’exploitation (rendements, revenus...) mais aussi de la filière (ainsi la production de biocarburant en filière courte à l’échelle de l’exploitation a un impact négatif à l’échelle de la filière qui a investi dans des infrastructures industrielles de traitement de ces biocarburants), les nuisances générées (odeurs, transports routiers induits....) et les impacts environnementaux locaux (qualité des eaux, de l’air...) et globaux (émission de gaz à effet de serre, séquestration de carbone...).
Les politiques publiques et les marchés : leurs rôles respectifs et leur cohérence vis à vis du développement durable
Un article récent du
Monde pose le problème de la diminution de diversité des cultures de l’agriculture française.
Une des raisons invoquées est le régime de la politique agricole commune qui a conduit les agriculteurs a abandonner les cultures n’ayant pas ou peu de primes au bénéfice des cultures les plus primées.
Le nouveau régime de la PAC découlant de l’accord de Luxembourg devrait inverser cette tendance.
On a bien là un exemple de relation entre politique agricole et durabilité du développement général de la société. C’est bien évidemment loin d’être le seul comme en témoignent à une toute autre échelle les effets sur le développement des pays du sud des aides apportées aux agriculteurs européens par la PAC. La notion de développement durable insiste sur la solidarité intergénérationnelle mais la solidarité entre sociétés à une même époque est aussi un impératif.
L’évolution des marchés joue aussi un rôle majeur et l’on rejoint ici le 1er angle de vue. Les accords de Kyoto de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le cours du pétrole créent ainsi un nouveau débouché pour l’agriculture, celui des biocarburants (à moins que ce ne soit qu’un retour aux sources, l’agriculture ayant été longtemps productrice du « carburant » nécessaire aux chevaux quand ils n’étaient pas vapeur). Les surfaces de cultures énergétiques vont-elles modifier le paysage ? vont-elles réduire la biodiversité, naturelle et cultivée ? L’impact qu’elles auront découlera en tous cas des politiques mises en œuvre.
L’article récent de
JC KROLL propose un panorama général des relations entre politiques et développement durable de l’agriculture.
En conclusion (non définitive), quelques idées-forces :
-
les yaka et faucon sont inefficaces pour une problématique aussi complexe que les relations entre agriculture et développement durables. La connaissance des différents tenants et aboutissants est nécessaire pour agir et le placage de « recettes stéréotypées» à toute situation sera rarement efficace
-
comme cette introduction sous forme de patchwork a voulu le montrer, différents niveaux d’action sont, non seulement possibles, mais nécessaires pour aborder agriculture et développement durable. De ce fait, la concertation entre les acteurs d’un côté et les approches interdisciplinaires de l’autre sont des impératifs méthodologiques.
-
les politiques ont une grande responsabilité dans ce qui se fera ou ne se fera pas.
Les risques associés à l’activité agricole
Généralement, on définit le risque comme la possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition à un danger ou à un phénomène dangereux. Le risque est la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement redouté (incident ou accident) et la gravité de ses conséquences sur une cible donnée. Dans le cadre de l’agriculture, il existe un certain nombre de risques intervenant au niveau de l’utilisation d’intrants (engrais, produits phytosanitaires) dans le système de production agricole, de la dissémination des gènes (du fait de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés par exemple), de la biodiversité, de l’érosion des sols, de la sécurité alimentaire, de la santé publique…
Sources de pression de l’agriculture sur l’Environnement
L’impact sur l’environnement de certaines pratiques agricoles n’a donné lieu que tardivement à une prise de conscience généralisée. L’agriculture, grande utilisatrice de biens environnementaux tels que l’eau ou le sol, est aussi créatrice de certains d’entre eux comme la diversité des habitats et des paysages.
Mise en évidence il y a plus dans les années, la réelle prise de conscience de la pollution de l'environnement par les pouvoirs publics et les acteurs économiques intervient surtout à partir de la fin des années 80. La dégradation de cette dernière est liée à la présence d'activités humaines qui souillent l'eau utilisée ou déversent dans le milieu naturel des substances polluantes. Les rejets peuvent être domestiques, caractérisées par la présence de bactéries pathogènes, de matières en suspension, de matières organiques (azote, phosphore), industriels (industries agro-alimentaires, sous-produits des industries chimiques et traitement de surface) ou liés à l'activité agricole. C'est ce dernier point que nous allons développer du fait de sa prédominance.
Les dommages environnementaux restaient souvent perçus comme le prix à payer des gains de productivité de l’agriculture. Et rétrospectivement, ces gains de productivité ont été impressionnants : d’une situation de pénurie et de dépendance alimentaire après la guerre, la France est devenue première productrice en Europe de produits agricoles, et deuxième exportatrice dans le monde. Cette croissance a été acquise par la concentration et la spécialisation des exploitations, avec le remembrement et une augmentation de l’utilisation d’intrants (produits phytosanitaires, engrais...).
Sources de pression : les risques liés aux engrais azotés
Vraisemblablement, de par la visibilité de leurs impacts, la principale source de pollution dénoncée fut les nitrates. En effet, cette pollution se caractérise par des phénomènes d'eutrophisation (occasionnant une moindre oxygénation des milieux naturels), le développement des marées vertes. Exemple significatif de l'ampleur de la dégradation de l'environnement liée aux nitrates, la Bretagne est classée dans son ensemble en zone vulnérable selon la directive européenne "Nitrates (n°91/676, du 12 décembre 1991) et, en 2000, 71 cantons sont répertoriés comme des Zones d'Excédents Structurels (ZES), c'est-à-dire des zones sur lesquelles plus de 170 kg d'azote d'origine animale sont apportés par hectare (voir
ressource).
Les sols sont également exposés au risque d'eutrophisation lorsque la quantité excessive de substances nutritives entraîne la raréfaction de l'oxygène dans les sols et empêche donc les micro-organismes naturels de fonctionner correctement.
Les nitrates proviennent en grande partie de l'agriculture sous forme de déjections animales (bovins…) et d'engrais de synthèse, et des rejets industriels et domestiques. Au centre du problème des nitrates, la fertilisation excessive. Elle correspond en réalité à deux problèmes :
-
L'excès d'azote apporté par rapport au rendement visé, qui peut venir d'un apport superflu à des fins d'assurance ou d'une mauvaise appréciation du reliquat disponible dans le sol. Dans ce cas, améliorer la mesure des besoins de la plante et des contenus du sol sont les moyens de limiter cette fertilisation excessive a priori.
-
L'excès d'azote lié à la différence entre le rendement visé et le rendement réalisé. Il s'agit là d'une fertilisation excessive a posteriori. Plus le rendement visé par l'exploitant est élevé, plus il a de chances qu'un autre facteur devienne limitant pour la croissance de la plante et qu'il reste des fertilisants inutilisés dans le sol. Poursuivre de hauts rendements accroît donc la probabilité de ne pas réaliser l'objectif à cause de la déficience d'un autre facteur de croissance.
Si les techniques agronomiques peuvent améliorer l'adéquation entre le rendement visé et celui qui est réalisé, des paramètres extérieurs peuvent à tout moment limiter la récolte par rapport aux aspirations, même si elles avaient été données sur des mesures sérieuses. A l'augmentation de la dose d'azote s'ajoutent deux autres causes de montée des nitrates dans les eaux : l'évolution des pratiques agricoles (comme le drainage, la mise à nu des terres en hiver) et un enrichissement des terres en azote minéralisable. C'est donc la logique même de l'agriculture intensive qui est au cœur du problème.
Sources de pression : les risques liés aux produits phytosanitaires (ou pesticides)
Dès les années 60, des analyses scientifiques ont montré l'impact des pesticides sur l'environnement, mais ce n'est que dans les années 90 qu'il a été réellement pris en compte. Ceci résulte en partie de trois phénomènes : la nature des produits, une méconnaissance de la pollution du fait de la difficulté de la mesurer et enfin, le nombre d'utilisateurs de pesticides.
Par suite de la banalisation de l'usage des pesticides, mélange de substances actives, d'adjuvants et de charge inerte, une forme de pollution plus complexe que celle lié aux nitrates est apparue. Pour R. Giovanni (1998, p.26), "il y a lieu de parler de micropollution généralisée (atmosphère, sols, eau, sédiments, êtres vivants) du fait du nombre élevé de molécules en cause, de leur diffusion aléatoire dans les milieux divers et les difficultés à les quantifier (du nanogramme à quelques microgrammes) comme de les arrêter entre le champ et le robinet ou la mer".
Les substances les plus souvent décelées dans les rivières sont des insecticides du sol et des herbicides utilisés dans la culture du maïs, des céréales ou l'entretien de zones non cultivées.
Les conséquences de la contamination par les pesticides sont extrêmement complexes puisque bien qu'utilisées a priori contre des organismes-cibles particuliers, les pesticides sont susceptibles d'exercer une activité toxique vis-à-vis d'autres organismes-non-cibles. Le problème est d'autant plus important qu'il s'agit de substances xénobiotiques (dont l'objectif est de tuer) et que lors des traitements phytosanitaires, 40 à 75 % des quantités épandues tombent au sol ou se volatilisent, les molécules pouvant atteindre plus ou moins vite les fossés puis les ruisseaux.
Difficiles à étudier dans les milieux naturels, les effets des pesticides sur l'environnement dépendent de la multiplicité des substances utilisées dont l'importance n'est pas seulement corrélée aux quantités, mais aussi à un ensemble de facteurs chimiques et physiques : le ruissellement, la solubilité, la durée de vie (indicateur de demi-vie), l'absorption (KOC, grandeur qui permet de comparer les sols à partir du coefficient de partage entre carbone et eau), la volatilité et les réactions à l'ionisation et de dégradation (métabolites, c'est-à-dire la décomposition de la molécule–mère en d'autres molécules, qui sont tout aussi toxiques). L'ensemble de ces paramètres montre qu'il existe une variabilité d'impacts possibles des pesticides sur l'environnement.
Enfin, la variété d'utilisateurs (agriculteurs, SNCF, collectivités locales, particuliers…) constitue aussi une source de difficulté quant à la mise en place d'actions de limitation des impacts des pesticides.
Comme on peut le voir, la problématique des pesticides ne s’apparente pas à celle des nitrates. Dans ce dernier cas, c’est plus particulièrement l’agriculture, tenue pour responsable à hauteur de 80% des dégradations liées à l’usage excessif de fertilisants azotés, qui est visée. Ce n’est pas le cas pour les produits phytosanitaires. En effet, les produits phytosanitaires utilisés pour l'agriculture ou pour des activités non-agricoles, du fait de leurs caractéristiques, évoluent différemment suivant que les molécules sont plus ou moins mobiles et/ou rémanentes. L'atrazine est mobile, le lindane l'est moins. La réalité du problème semble donc plus complexe que dans le cas de la pollution par les nitrates.
Sources de pression : les risques liés à la consommation d’eau
Outre les questions de la qualité de l’eau, la ressource en eau reste encore très sollicitée par l’activité agricole. Les volumes d’eau consommés par l’irrigation représentent sur l’année environ la moitié des volumes totaux consommés et atteignent 80% de ceux consommés pendant la période estivale, qui est la période la plus sensible pour les milieux naturels. La consommation d’eau pour l’irrigation est concentrée dans le sud de la France : 74 % de celle-ci est localisée dans les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. Environ 1,5 million d’hectares (soit 5% de la Surface Agricole Utile) sont aujourd’hui irrigués en France, la superficie équipée s’élevant à 2,5 millions d’hectares. Plus de la moitié de la surface irriguée est dédiée à la culture du maïs.
Les risques « agricoles » divergent selon les formes d’agriculture pratiquée. Entre une agriculture dite conventionnelle et une agriculture biologique, la voie s’est largement ouverte ces dernières années pour le développement de pratiques différentes visant à réconcilier agriculture et environnement. Chaque forme d’agriculture ou régime d’activité agricole visera à se conformer avec un développement durable, tout en maintenant sa spécificité dans l’appréhension et l’atteinte de ces objectifs. Le tableau ci-dessous l’illustre clairement.
| Formes d’agriculture | Définition | Objectifs |
| Agriculture Biologique | Concept global qui s’appuie sur le choix de valeurs comme le respect de la terre et des cycles biologiques, la santé, le respect de l’environnement, le bien-être animal, la vie sociale, etc. C’est un mode de production agricole fondé sur un ensemble de techniques complexes excluant l’utilisation de produits chimiques de synthèse. (FNAB) | Respect des écosystèmes
Respect de la santé humaine et animale
Recherche d’un développement économique cohérent |
| Production Fermière | Agriculture dont la spécificité réside dans le fait que les personnes impliquées remplissent plusieurs fonctions : celle de produire, transformer, et vendre leurs produits auprès des consommateurs. Les producteurs fermiers sont impliqués dans l’évolution de la société : réponse aux attentes des consommateurs, création d’activité et d’emplois, revitalisation des territoires et développement d’un espace rural vivant. Ils participent ainsi au maintien du lien ville-campagne. (FNAPF) | Créer de la valeur ajoutée par la transformation et la vente
S’engager dans une démarche de qualité des produits
Favoriser un échange entre producteur et consommateur
Participer au développement harmonieux du territoire |
| Agriculture Paysanne | L’agriculture paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie apprécié par tous. (Fadear) | Respect des sociétés paysannes et de l’emploi agricole et rural réparti sur le territoire, sur des exploitations à taille humaine |
| Agriculture Durable | L’agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement viable, saine pour l’environnement et socialement équitable. L’agriculture durable est une agriculture soutenable car elle répond aux besoins d’aujourd’hui (aliments sains, eau de qualité, emploi et qualité de vie) sans remettre en cause les ressources naturelles pour les générations futures. (RAD). | Promouvoir des systèmes de productions autonomes et économes
Rendre les exploitations viables, vivables et transmissibles
Constituer des espaces d’échanges entre paysans et citoyens |
| Agriculture Raisonnée | Agriculture compétitivité qui prend en compte des manière équilibrée les objectifs économiques des producteurs, les attentes des consommateurs et le respect de l’environnement. L’agriculture raisonnée fait la démonstration qu’il est possible de concilier : rentabilité de l’exploitation, préservation du milieu naturel, production de qualité, régulière et à des prix abordables, contribution de l’agriculture à l’économie nationale. (FARRE) | Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et des engrais
Axe de communication visant à améliorer l’image de marque des agriculteurs
Devenir le futur standard de l’agriculture française |
| Production Intégrée | Système agricole de production d’aliments et des autres produits de haute qualité qui utilise les ressources et des mécanismes de régulation naturels pour remplacer des apports dommageables à l’environnement et qui assure à long terme une agriculture viable. (OILB) | Base de repère pour les scientifiques européens
Développement et applications des concept de la protection des végétaux basés sur l’écosystème |
| Agriculture de Précision | Utilisation des nouvelles technologies qui se développe aujourd’hui dans le monde agricole pour ajuster les pratiques culturales au plus près du besoin des plantes en fonction de l’hétérogénéité intra-parcellaire. (ITCF) | Accroître les bénéfices et la compétitivité des produits
Mise au point d’outils d’analyse et d’aide à la |
Profil du « risque » associé aux pratiques agricoles
L’impact de l’agriculture sur l’environnement (phénomène d’eutrophisation des rivières, de marées vertes…) et sur la santé humaine (développement de cancers, intoxication…) varie selon les caractéristiques géologiques, pédologiques, météorologiques… mais aussi en fonction des pratiques agricoles. Ainsi, par exemple, suivant les types de sols, le ruissellement des engrais azotés sera plus ou moins importants. De même, suivant les conditions de pulvérisation des pesticides, la volatilisation sera différente selon la présence ou non de vent, le dégrée d’hygrométrie… En ce qui concerne les impacts des pratiques agricoles, elles vont se différencier selon, par exemple :
-
La quantité et les caractéristiques des intrants organiques (fumier, lisier…) et de synthèse tels que les pesticides et les engrais chimiques.
-
Les pratiques limitant l'érosion et la dégradation des sols (le non-labour, la couverture végétale des sols, les haies…).
-
La rotation des cultures sur un cycle plus ou moins long
-
Les actions qui réduisent l'usage d'intrants et protégeant les ressources en eau (bandes enherbées autour des ruisseaux et rivières…).
-
Le recours à des processus naturels et régénérateurs, comme les cycles nutritifs, la fixation biologique de l'azote, la reconstitution des sols et les ennemis naturels des ravageurs (les coccinelles contre les pucerons…).
-
Les actions visant à réduire la production de déchets non réutilisés en créant des interdépendances avec d'autres activités économiques, dans un objectif de plus grande efficacité globale
-
Les actions favorisant l'utilisation des sous-produits de l'activité agricole ou de toute autre activité (par exemple, utilisation de déchets humains (sécurisés/compostés ou méthanisés).
-
Les actions visant à réduire l’usage de pesticides qui peuvent nuire à la santé des agriculteurs et des consommateurs et à la biodiversité.
Outre les caractéristiques physiques des zones agricoles, la question qui se pose est celle des bonnes pratiques agricoles. Elles sont définies comme un ensemble de règles à respecter dans l’implantation et la conduite des cultures de façon à optimiser la production agricole, tout en réduisant le plus possible les risques liés à ces pratiques, tant vis-à-vis de l’homme que vis-à-vis de l’environnement. En France, un « code national des bonnes pratiques agricoles », d'application volontaire en dehors des zones vulnérables, a été défini en application de la directive européenne « Nitrates ».
Le code ne traite explicitement que de la pollution des eaux par les nitrates issus des activités agricoles mais s’applique également pour les produits phytosanitaires. Il s'appuie sur les bases scientifiques et techniques existantes. L'objectif de ce code est de réduire les transferts de nitrates vers les eaux souterraines et de surface. Il a fait l'objet d'un arrêté du ministère de l'Environnement en novembre 1993. Le code comprend :
-
un ensemble de recommandations sur l'épandage, le stockage des engrais de fermes dans les exploitations, la gestion des terres et de l'irrigation ;
-
une base minimale pour les programmes d'action en zone vulnérable, prévus dans la directive « nitrate » ;
-
un cahier des charges pour les différents opérateurs du monde agricole (institutionnels, distribution, etc.).
Par ailleurs, les ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture ont mis en place en août 2000 un programme de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires, afin de renforcer les contrôles réalisés sur ces derniers. Celui-ci prévoit des mesures au niveau national et au niveau régional. L’ensemble de ces orientations ont été traduites (et parfois anticipées dans un projet plus large d’évolution de l’agriculture) de manière différente selon les formes d’agricultures (voir tableau ci-dessous)
| Formes d’agriculture | Pratiques agricoles | Mode d’Evaluation |
| Agriculture Biologique | Concerne toutes les productions
Produits chimiques de synthèse interdits
Rotations culturales longues
Gestion des matières organiques (fumier…) | Cahier de charges par production
Contrôle indépendants
Certification
Attribution de la marque AB |
| Production Fermière | Concerne toutes les productions
Matières premières issues exclusivement de la ferme
Maîtrise et responsabilité du produit
Transparence/consommateur
Accueil du public
Entretien de l’espace rural | Charte nationale des producteurs fermiers
Cahiers de charges par produit et par terroir |
| Agriculture Paysanne | Concerne toutes les productions
Autonomie en protéines
Réduction des intrants (engrais, pesticides)
Rotations culturales longues
Gestion des pâturages
Produits fermiers
Entretien de l’espace rural | Charte de l’agriculture paysanne
Indicateurs socio-économiques
Diagnostics agri-environnementaux |
| Agriculture Durable | Concerne toutes les productions
Réduction des intrants (engrais, pesticides)
Rotations culturales longues
Gestion des pâturages
Autonomie en protéines
Entretien de l’espace rural | Cahiers de charges par production
Contrôles indépendants (dans certains cas)
Certification (idem)
Attribution de la marque agriculture durable (idem) |
| Agriculture Raisonnée | Concerne toutes les productions
Respect de la réglementation
Cahiers d’enregistrement
Locaux de stockage fermés
Analyses des sols
Réglage du matériel | Socle de recommandations
Guides techniques professionnels
Possibilité de contrôles externes |
| Production Intégrée | Systèmes plus utilisés en Europe du Nord qu’en France
La lutte biologique concerne l’arboriculture, la viticulture, les culture
Bien-être animal
Rotations culturales longues | Directives et recommandations
Cahiers de charges par production· Agrément
Label « Production Intégrée » |
| Agriculture de Précision | Concerne les grandes cultures, l’arboriculture, la viticulture
Nouvelles technologies de l’information
Instruments de mesure électroniques (GPS, Système d’information géographique,…) | Evaluation par une gestion de la variabilité intra-parcellaire : correction, modulation, amélioration |
Compte tenu de la variété des pratiques agricoles et de la complexité d’évaluation de l’impact de ces dernières sur l’environnement et sur la santé humaine, un certain nombre d’
outils d’évaluation et de diagnostic ont été conçus. Ils visent à fournir un ensemble d’informations et d’indicateurs, permettant à l’agriculteur d’inscrire ces pratiques agricoles dans l’optique de la durabilité. Cependant, outre les difficultés liées à la nature des pressions (pesticides, engrais, irrigation…) ou des biens environnementaux tels que la biodiversité et les paysages, des problèmes d’échelles temporelles et géographiques entre les indicateurs des pressions agricoles et ceux de l’état des milieux, ainsi que l’influence importante des conditions climatiques rendent parfois délicates les interprétations. Des améliorations restent de ce fait nécessaires, concernant notamment les paysages, les sols et la biodiversité.
Contexte et enjeux associés aux choix de l’agriculteur
Ayant mis l’accent dans les points précédents sur les pratiques agricoles, il nous semble important de faire un point sur les forces motrices, c’est à dire les causes des pressions exercées, qui doivent aussi être analysées (orientation des politiques agricoles nationales et européennes…)(
http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=3887).
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’accroissement des échanges, les progrès techniques, la diminution du prix des intrants, l’évolution du machinisme agricole et la croissance de la demande ont favorisé la modernisation de l’agriculture française, permettant ainsi l’autosuffisance alimentaire et une forte croissance de la production. Ces éléments ont également conduit à des substitutions entre terre et capital, initiatrices de pressions, à l’instar de celles liées à l’élevage hors sol.
La Politique Agricole Commune européenne a aussi structuré très largement l’évolution de l’agriculture et la
politique agricole nationale. Les réformes successives (1992 et de 1999) ont permis d’intégrer progressivement les préoccupations environnementales. Cependant la faible part des aides agro-environnementales dans les budgets, la dispersion des mesures sur le territoire et l’utilisation au sein d’une même politique d’instruments aux objectifs et effets antagonistes – favorisant, d’une part, une intensification de l’agriculture et, d’autre part, la protection de l’environnement – n’ont finalement pas permis d’inverser significativement les tendances par rapport à l’environnement.
Une réorientation de la PAC en Europe est actuellement à l’œuvre et l’environnement a été affiché comme l’un des objectifs de cette réforme. Les accords de Luxembourg de 2003, caractérisés par un découplage des aides de la production, introduisent plusieurs outils intéressants concernant l’environnement : la conditionnalité des aides au respect d’exigences environnementales, la possibilité d’augmenter les montants alloués aux mesures de développement rural (parmi lesquelles figurent des aides environnementales) et plus généralement aux types d’agriculture favorables à l’environnement.
De même, l’articulation entre politique environnementale et activités agricoles peut être développée. D’une part, les politiques agricoles, qui, à l’instar des politiques foncières, visent plusieurs objectifs à la fois, n’ont pris en compte que progressivement l’environnement et ne lui ont pas accordé assez de place. D’autre part, les politiques à visée environnementale qui se préoccupent d’abord des réponses à apporter par domaine (eau, air, nature...) ont longtemps abordé l’agriculture dans le seul but de limiter ses impacts négatifs sur l’environnement.
Dans ces différents domaines, l’utilisation de la réglementation a été souvent privilégiée. Elle interdit ou limite l’utilisation de certain produits (phytosanitaires), encadre les prélèvements de ressource (ressources en eau) ou les quantités de produits polluants utilisables (pour la pollution de l’eau d’origine azotée par exemple) ; elle définit aussi dans certains cas des zones auxquelles sont attachées des prescriptions particulières.
La réglementation est nécessaire mais elle a montré certaines limites dans le domaine agricole : sa mise en œuvre butte souvent sur une insuffisance des contrôles (par exemple pour l’épandage d’azote organique). Ses contournements possibles limitent son efficacité. La réglementation peut également s’avérer peu adaptée pour prévenir l’apparition de situations de crise, en matière de ressources en eau, par exemple.
Il existe aussi des instruments économiques tels que les taxes ou redevances environnementales qui peuvent inciter les agriculteurs à modifier leurs comportements. Mais ces taxes sont pour l’instant limitées aux produits phytosanitaires et aux prélèvements d’eau et leurs taux sont faibles au regard des dommages occasionnés, ce qui limite leur impact sur les comportements.
Par ailleurs, des mesures contractuelles basées sur une coordination des agriculteurs et sur des contrats d’adoption volontaire de modification des pratiques ont dans certains cas donné des résultats encourageants sur le plan environnemental : pouvant être plus facilement adaptées aux problématiques locales, elles nécessitent toutefois pour être efficaces qu’un nombre suffisant d’agriculteurs adhère à la démarche.
Si les pratiques agricoles peuvent intégrer ces services environnementaux sous l’effet des politiques environnementales ou agricoles et limiter leurs impacts négatifs sur l’environnement, le consommateur peut aussi révéler ses attentes environnementales par le biais d’une valorisation accrue des produits issus de modes de production respectueux de l’environnement.
Les nouvelles perspectives offrent aussi un rôle important à l’agriculture vis à vis de l’environnement en réduisant l’impact environnemental d’autres secteurs économiques par le biais des biocarburants ou des produits issus de la « chimie verte » (voir
ressource).
Enfin, en termes de prospective, les relations entre l’environnement et l’agriculture pourraient être fortement modifiées par l’émergence des problèmes environnementaux globaux, au premier rang desquels figurent les effets du changement climatique (cf : module "Changement Climatique"). Les progrès techniques avaient permis à certaines activités agricoles d’être moins dépendantes de certaines situations, telles que la qualité des sols, la disponibilité de l’eau ou les pressions parasitaires. Le changement climatique induit par l’accroissement des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, pourrait accroître à nouveau la sensibilité de l’agriculture à l’environnement en créant des situations inédites : modifications des zones de cultures, apparition de nouveaux parasites, accroissement des rendements mais aussi des risques associés, successions de périodes de sécheresse et de pluies orageuses provoquant des érosions et des inondations, réduction possible enfin des conditions d’irrigation dans certaines régions du sud de la France.