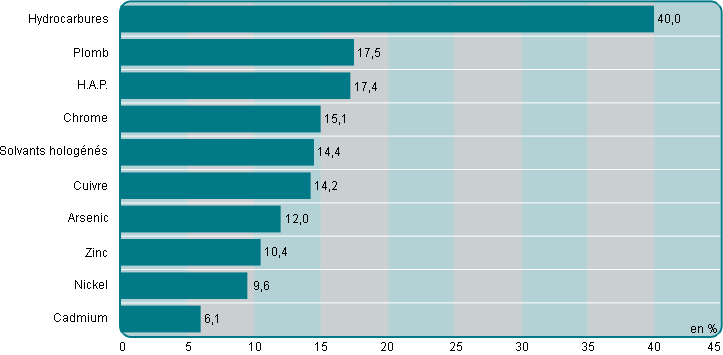Un risque omniprésent, longtemps sous évalué
Les questions de pollution des sols par les activités industrielles ne font l’objet d’une prise de conscience que depuis peu de temps, une vingtaine d’années tout au plus, au regard de plus de deux siècles d’activité industrielle. Il y a encore vingt ans, la contamination des sols était habituellement perçue comme générée par de rares incidents, avec de possibles conséquences catastrophiques sur la santé humaine et l’environnement (même s’ils étaient alors mal connus). Aujourd’hui, la contamination des sols n’est plus perçue comme le résultat de quelques incidents, mais bien comme un problème largement répandu, avec des très lourdes conséquences sur la santé et l’environnement.
L’omniprésence des sites pollués
Le site Basias (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) crée en 1994 pour construire la mémoire industrielle des sols français recense en 2006 entre 300 et 400 000 sites sur 66 départements pour lesquels un inventaire historique régional devra être mené pour identifier d’éventuelles pollutions (voir figure 1). Le site Basol lui propose une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif : 3 717 sites industriels pollués ou susceptibles de l’être sur lesquels une action des pouvoirs publics a été engagée .
Les cartes font bien apparaître l’ampleur des sites concernés et le poids des régions industrielles comme le Nord-Pas-de-Calais, les départements de la Moselle et des Bouches-du-Rhône, l’Île-de-France étant la plus touchée. Presque tous les départements sont concernés, chacun selon son histoire industrielle. La variété des « profils de pollution » est liée à l’origine extrêmement diverse des pollutions. Selon l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) il existe 3 grands mécanismes de pollution de site : accidentel, chronique et localisé voire diffus. Il s’agit le plus souvent :
-
d’anciennes décharges, de dépôts de résidus (miniers, d’incinération) ou de produits chimiques abandonnés, qui par le passé ont été utilisés sous forme de remblais ;
-
d’infiltrations ou déversements de substances (par exemple des hydrocarbures) ;
-
de retombées de poussières consécutives à des rejets atmosphériques accumulés sur de longues périodes.
Les sources de contamination du sous-sol (sols et eaux) sont ainsi essentiellement le fait des anciens terrains industriels, hérités de plus de deux siècles d’industrialisation où les exploitants ont pu librement déverser les résidus toxiques sur leur site d’activité. Par diffusion, il faut donc ensuite considérer les terrains proches des anciennes zones contaminées. Pour les activités industrielles, selon la typologie de Dominique Darmendrail basée sur les chiffres nationaux de 1996, les principales activités sources répertoriées sont les industries des métaux ferreux, les industries chimiques et pharmaceutiques, le traitement et l'élimination des déchets, les industries du pétrole et du gaz naturel, les cokeries et usines à gaz de ville (Darmendrail, 2001).
A ces sites d’activités s’ajoutent les sols pollués par les décharges et les dépôts sauvages de déchets. Il faut attendre la loi de 1993 pour que les décharges soient supprimées et que les centres d’enfouissement veillent aux conditions de stockages des déchets dangereux. Enfin, il faut considérer les terrains sur lesquels ont été exercées des activités de service (comme les stations services) ainsi que les terrains remblayés (carrières, terrains rehaussés le long des cours d’eau).
A côté des sites de pollution industrielle, il faut tenir compte des effets des pollutions agricoles, elles plus diffuses. L’INERIS (L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques) considère que ces sols sont sujets à des contaminations biologiques et chimiques répétées, notamment du fait des épandages (lisiers, engrais, boues, pesticides...), avec un éventuel effet d’accumulation à considérer. L’impact sur l’exposition par la voie alimentaire (aliments et eaux de boisson) dépend des pratiques agricoles, des espèces cultivées et élevées, et de l’aval des filières agro-alimentaires. Au final, elle estime qu’à la suite des transferts, pendant de longues durées, provenant de sources naturelles ou anthropiques, « tous les sols en France sont peu ou prou contaminés »(2). Elle propose de les classer dans les quatre catégories suivantes :
-
Les sites qui sont ou ont été occupés par des installations de production ou de stockage impliquant des substances nocives.
-
Les zones à contaminations multiples situées au voisinage de sites industriels, des sources de pollution urbaines ou des infrastructures et qui peuvent s’étendre sur plusieurs communes ou une partie de département
-
Les terrains agricoles.
-
Les zones forestières et naturelles, qui ne sont pas indemnes de risques, en raison notamment de leurs caractéristiques naturelles (gîtes minéraux, apports sédimentaires...), mais aussi des retombées atmosphériques (retombées radioactives comme Tchernobyl), des transferts par l’eau (par exemple les inondations des zones humides) et des déchets dispersés (par exemple les plombs de chasse, l’uranium issu des résidus des extractions minières). Ces situations ont été peu étudiées sur le plan sanitaire et environnemental.
Il faut maintenant se demander pourquoi les pouvoirs publics ont tant attendu pour apprécier l’ampleur d’un tel risque.
Un risque longtemps sous estimé et mal connu
En 1997, le MEDD recensait seulement 897 sites pollués alors qu’aujourd’hui 3 717 sites industriels font l’objet d’une intervention de dépollution des pouvoirs publics et 300 000 sont identifiés comme pouvant être source de pollution.
Pour comprendre comment les pouvoirs publics ont pu laisser les entreprises et les particuliers rejeter leurs polluants dans le sol, Frédéric Ogé et Pierre Simon rappellent que les scientifiques ont peu remis en cause l’idée que le sol gardait la pollution, voire fonctionnait comme un épurateur (3). D’autre part, les effets des polluants étaient méconnus, effets d’autant plus insidieux qu’avec le temps la pollution peut augmenter : certains polluants en se dégradant donnent lieu à des dérivés chimiques plus toxiques et plus résistants. Les produits peuvent migrer sous l’action des pluies dans le sol pour ressortir des kilomètres plus loin, contaminer les nappes phréatiques, ou prendre une forme gazeuse en surface.
Les polluants des sites sont principalement de nature chimique. Les tableaux récapitulatifs (tableaux 1,2 et 3) mettent en relation les types de polluant avec les activités humaines et les dangers associés. Ils distinguent les éléments traces (tableau 1) qui ne posent problème qu’en cas d’accumulation et de transfert, les polluants organiques (tableau 2) qui eux sont transformables et dégradables sous l’effet de phénomènes physiques, chimiques, et biologiques, et une dernière catégorie qui regroupe les composés mixtes (organométalliques), les minéraux, et les composés radioactifs (tableau 3). Les risques sanitaires et environnementaux sont importants, depuis l’intoxication aiguë jusqu’au cancer, les affections cérébrales et les malformations des fœtus. Pour l’environnement, il s’agit aussi bien de la contamination des eaux et la disparition de la ressource que de celles de la faune et la flore.
Tableau 1 : Les métaux et métalloïdes associés par ordre décroissant de probabilité de présence (auteur Fiori, d'après Ogé et Simon (4))
| nature polluant | activité source | effets sur l’homme | effets sur l’environnement |
| Plomb (Pb) | batteries, pigments, alliages, peintures (oxyde) | affections cérébrales (saturnisme) | plombémies végétales et animales |
| zinc (Zn),
Chrome (Cr),
cuivre (Cu),
nickel (Ni),
sélénium (Se), | Céramiques, chimie, colorants, traitement de surfaces, imprimerie, électronique, pharmacie, textile, photographie, verre, insecticides, métallurgie, peintures, piles, caoutchouc, tanneries, engrais | cancers, affections hépatiques, digestives et rénales, asthme, bronchites chroniques, inflammations des muqueuses et ulcères | contamination des eaux souterraines |
| Arsenic (As) | Céramiques, chimie, verre, métallurgie, mines d’or, fongicides, tanneries | agression du tube digestif, foie, rein, cœur, système nerveux, peau | contaminations végétales, perturbation du développement des céréales (maïs, orge, seigle, et de la fabrication de chlorophylle |
| nickel (Ni),
composés à base de sélénium (Se), | Pièces de monnaies, alliages en métallurgie, cathodes d’accus, colorants, photocopieurs, photovoltaïque | Cancer du poumon, allergies, irritations cutanées, oculaires ou respiratoires | fertilité des animaux |
| Cadmium (Cd) | Céramiques, colorants, métallurgie, piles, réacteurs nucléaires | cancers, affections des reins | contamination des végétaux et des animaux |
| Mercure (Hg) | Thermomètres, baromètres, chapeaux, électronique, hôpitaux, métallurgie, luminaires, mines d’or, papeteries, peintures, piles | affections cérébrales (hydrargyrie) | contaminations mercurielles des végétaux et des animaux |
Tableau 2 : Les contaminants organiques (Fiori, d'après Ogé et Simon)
| nature polluant | activité source | effets sur l’homme | effets sur l’environnement |
| dioxine de Seveso | Incinérateurs | chloracné | Pollution des sols, végétaux et animaux |
| Huiles, Hydrocarbures | Cokeries, garages, raffineries, pétrochimie, traitement des traverses, stations-service, usines à gaz | cancers | végétaux plus vulnérables |
| Solvants pétroliers (COV) (ex : hexane) | Garages, peintures, traitement du bois, cuir, textile, imprimerie, colorants | atteinte des poumons en cas d'ingestion, nocif, irritant, | production d'ozone, toxique pour les milieux aquatiques |
| hydrocarbures halogénés (ex : trichloréthylène) | Solvant, nettoyage | Agressions de la Peau, des muqueuses, du système nerveux | Pollution des sols, végétaux et animaux |
| HAP, BTEX Phénols, PCB | Chimie, cokeries, pharmacie, lubrifiants, plastiques, papier, insecticides, traitement du bois, diélectriques, | irritation des muqueuses, atteintes rénales, cancers | frein à la biodégradation |
Tableau 3 : Les autres polluants : mixtes, minéraux et radioactifs (Fiori, d'après Ogé et Simon)
|
nature polluant
|
activité source
|
effets sur l’homme
|
effets sur l’environnement
|
| Isocyanates (Bhopal), Pesticides (biocides), détergents | Activités agricoles, désherbants (fabrication et utilisation,voies ferrées) | asthme | Pollution des eaux |
| dérivés azotés, phosphates, sulfates, | Chimie, élevages, engrais, combustibles, explosifs, fongicides, gypse | affection des vaisseaux | prolifération des algues, baisse de l’oxygène dans l’eau |
| amiante | Canalisations, dalles, isolants, fibrociments, freins | cancer du poumon et de la plèvre, fibroses, asbestoses | |
| chlorure de sodium (Na Cl) | | agressions pulmonaires, perturbation des influx nerveux | augmente la salinité des cours d’eau |
| Chlore (Cl) | | œdèmes pulmonaires, irritation des yeux, | |
| Cyanures (C≡N) | Extraction de l’or et de l’argent, cokeries, hauts fourneaux, usines à gaz, pétrochimie, traitement de surface | Perturbe le transport de l’oxygène | |
| fluorures | Colorants, verre, insecticides, métallurgie aluminium, traitement du bois | affaiblissement des défenses immunitaires, irrite les voies respiratoires | empoisonne les poissons, fait dépérir les plantes |
| Radionucléides | Mines d’uranium | | |
| poussières de diverses natures | chantiers, moteurs à combustions | attaquent les muqueuses nasales | se mélangent aux autres produits dont elles augmentent la toxicité |
Les polluants par ingestion et/ou inhalation considérés comme les plus préoccupants sont principalement :
-
Certains métaux lourds et métalloïdes connus pour leur pouvoir neurotoxique, comme le plomb, ou cancérogène, comme l’arsenic, le chrome VI, le cadmium- Certains hydrocarbures, en particulier le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), reconnus pour leur effet CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).
-
Beaucoup de solvants halogénés ou leurs produits de dégradation sont reconnus comme substances et préparations très toxiques, toxiques et nocives, parfois cancérogènes (par ex. le trichloroéthylène ou le chlorure de vinyle). Ils peuvent causer divers troubles, notamment neurologiques aigus et chroniques, cutanéo muqueuxW, hépato-rénauxW, cardio-respiratoires et digestifs.
En France, selon Basol, les principaux polluants recensés sont : les hydrocarbures, le plomb et les HAP.
Face au risque provoqué par l’accumulation de polluants chimiques, il faut maintenant préciser quelles sont les particularités du sol en tant que milieu et les processus de transfert qui s’y produisent. Trois propriétés du sol doivent être prises en compte pour l’appréciation de ces risques :
-
le sol est un milieu de transfert situé en interface avec les milieux aquatiques (eaux de surface et souterraines), l’atmosphère et la biosphère ;
-
il peut être contaminé sur de longues périodes, voire en permanence, par des agents biologiques ou chimiques, minéraux ou organiques, qui s’accumulent plus ou moins selon les cas et de façon plus ou moins réversible ;
-
ses modifications s’effectuent avec des constantes de temps beaucoup plus longues que pour les autres milieux ; ses hétérogénéités de contamination se conservent longtemps (par exemple des niveaux pollués sur une mince couche de surface ou entre deux couches non contaminées).
Une conjonction d’intérêts à ne pas informer le public
Il faut d’abord insister sur la difficulté à évaluer le risque et à établir une méthode probante d’évaluation de ce risque. Henri PEZERAT (toxicologue, directeur de recherche au CNRS) rappelle que si les produits cancérogènes sont connus (100 produits ou agents physiques sont cancérogènes avec certitude, 400 sont potentiellement dangereux), les cancers environnementaux sont plus difficiles à identifier que les cancers professionnels. En effet, la dispersion des polluants conduit à des concentrations beaucoup plus faibles d'agents cancérogènes. Selon l’AFSSET, l’estimation des expositions fait appel à la modélisation des transferts et à la mesure des polluants, méthodes qui présentent chacune certains inconvénients (5). Tous les auteurs reconnaissent que les cas ayant des effets sur la santé, imputables sans ambiguïté à la pollution des sols, sont rares. Des plombémies élevées ont parfois été mesurées, mais souvent sans que l’on puisse distinguer la part due au site pollué de celle due aux émissions actuelles du site industriel ou de celle due au bruit de fond local (cas des résidus de sites miniers dans des zones à fond géochimique élevé). Dans le cas particulier du quartier sud de Vincennes (années 1990- 2001), une densité inhabituelle de cancers d’enfants a été relevée, mais les études épidémiologiques et environnementales conduites n’ont pas indiqué de lien de cause à effet avec la pollution de l’ancien site industriel présent dans ce quartier.
Mais, s’il y a bien une vraie difficulté à apprécier les impacts sur la santé, Frédéric Ogé et Pierre Simon soulignent la rareté des enquêtes épidémiologiques : « Faute d’information suffisante il n’est pas aisé d’identifier la toxicité des produit auxquels on peut se trouver exposé ». Henri Pezerat reste très critique quant à la fiabilité des organismes de l’État en matière de détection des cancers environnementaux : « Le premier souci des pouvoirs publics reste d'éviter toute vague, toute mise en cause d'acteur économique de poids ou d'administrations défaillantes. Et les institutions de recherche, apparaissent incapables d'initiative, sans imagination, influencés par les milieux industriels ou paralysées par la peur de déplaire. » (6)
Frédéric Ogé et Pierre Simon s’interrogent sur les vertus d’un système où il existe de fait une connivence entre les personnels de l’État, chargés de surveiller les sites industriels; et les dirigeants des entreprises, formés souvent dans les mêmes grandes écoles. « Durant des décennies, ces hauts fonctionnaires habitués à traiter les problèmes sans mettre à mal leur solidarités professionnelles, n’ont pas jugé bon d’informer les Français d’en bas. La priorité était donnée à la production et non à la protection, quitte à encourager l’indemnisation quand la pollution devenant trop criante ou quand les médias y faisaient écho. » (op. cité, page 84) Et de rappeler que trop d’entrepreneurs refusent encore aujourd’hui des payer pour gérer au mieux leurs déchets. Cependant, ils terminent ce tour d’horizon des responsabilités partagées en insistant sur l’importance de l’information et du contrôle des citoyens sur les informations les plus sensibles.