Mercure, tout comme la Lune, n’ont sans doute jamais eu d’atmosphère importante, en raison d’un échappement atmosphérique rapide. En revanche, on pense qu’initialement, Vénus, la Terre et Mars avaient des atmosphères semblables, probablement composées de vapeur d’eau, CO2, N2, etc… à des pressions totales de quelques bar (il est évidemment impossible d’être plus précis). Elles ont donc connu des évolutions divergentes.
Vénus
Peu après la formation de Vénus, en raison notamment de la faible luminosité du jeune Soleil, la température sur Vénus devait être inférieure à 100°C, ce qui garantissait l’existence d’eau liquide, et donc d’un cycle de CO2. L’augmentation progressive du flux solaire conduisit cependant à une augmentation progressive des températures, qui favorisèrent le dégazage et une évaporation des océans. L’eau injectée dans l’atmosphère augmenta l’effet de serre, donc la température, ce qui favorisa d’autant l’évaporation atmosphérique. Les océans initiaux durent donc s’évaporer entièrement, et la vapeur d’eau atmosphérique diminuer par destruction due aux UV. A partir du moment où il n’eut plus d’eau liquide, le cycle du CO2 fut rompu, et le CO2 produit par le volcanisme s’accumula dans l’atmosphère, augmentant d’autant l’effet de serre. Cette succession d’effets cumulatifs conduisit à la situation actuelle avec une atmosphère de CO2 très dense (92 bar), très chaude (460°C), et très sèche.
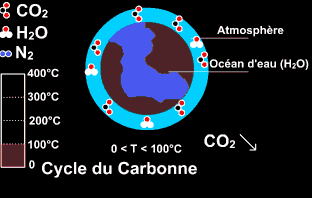
Crédits
Raphael Moreno et Gilles Bessou / Observatoire de Paris
Légende
Evolution de l'atmosphère de Vénus
Mars
Sur Mars, le climat initial était probablement humide et tempéré, avec des températures positives (grâce à l’effet de serre) et de l’eau liquide à la surface. Cette ère dura peut-être un milliard d’années – les observations les plus récentes de Mars suggèrent en effet une altération aqueuse de la surface jusqu'à il y a 3,5 milliards d’années. A la suite de quoi, il semble que l’atmosphère décrut assez rapidement, sans que l’on sache avec certitude pourquoi. Il est possible qu’elle disparut à la suite d’un ou plusieurs événements catastrophiques de type impact météoritique majeur, ou qu’elle diminua plus progressivement à la suite de l’extinction progressive de l’activité volcanique. Mars est en effet plus petite que ses deux sœurs, et la quantité d’éléments radioactifs qui fournissent l’énergie interne de la planète plus faible. L’arrêt du cycle du CO2 faute de régénération volcanique conduisit à une décroissance de la pression atmosphérique. Quelle qu’en soit la cause, celle ci s’accompagna d’une décroissance de l’effet de serre, donc des températures, jusqu’à ce que celles-ci passent en dessous de 0°C. L’eau dut donc geler et passer dans le sous-sol, sous forme de «
pergélisol
». Peut-être ancien Eden, Mars est maintenant une planète aride et froide, avec une atmosphère ténue peu protectrice des UV solaires.
Terre
Sur Terre enfin, le cycle du CO2 et l’apparition de la vie ont semble-t-il permis un climat d’une grande stabilité. L’élimination progressive du CO2 dans les océans a harmonieusement compensé l’augmentation de la luminosité solaire. En effet, l’augmentation du flux de chaleur solaire a dû engendrer une évaporation accélérée; celle-ci s’est accompagnée d’une augmentation des pluies, qui a favorisé la dissolution du CO2 dans les océans et son piégeage dans les carbonates, et donc une décroissance de l’effet de serre. Du coup, l’effet global sur la température est resté minime. Enfin, l’apparition de la vie a bouleversé la composition de l’atmosphère de la Terre, puisque la majorité du CO2 a été transformé en O2. Le démarrage de la vie marine a d’abord créé une mince couche d’oxygène moléculaire. Celle-ci a donné naissance par photochimie à une couche d’ozone, qui en protégeant la surface, a permis l’apparition de la vie terrestre il y a 500 millions d’années et son explosion au Carbonifère il y a 300 millions d’années. Cette période, caractérisée par une intense conversion du CO2 en O2 et la formation des réserves fossiles en carbone, a dû s’accompagner d’une baisse de la température sur le globe (l’évolution actuelle, avec la combustion massive de ces réserves fossiles et le réchauffement global qui en découle, semble donc refléter le processus inverse). L’azote est resté assez stable tout au long de l’histoire de l’atmosphère terrestre, étant produit en permanence par le volcanisme.